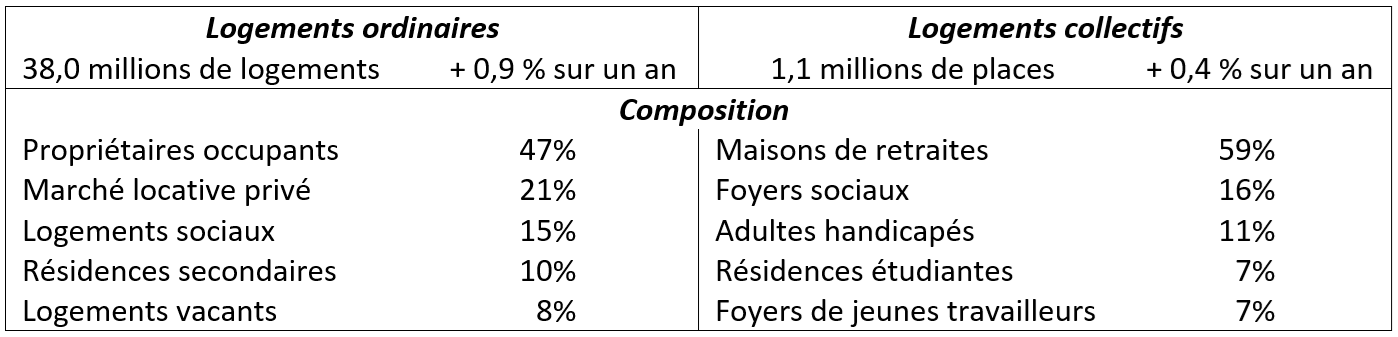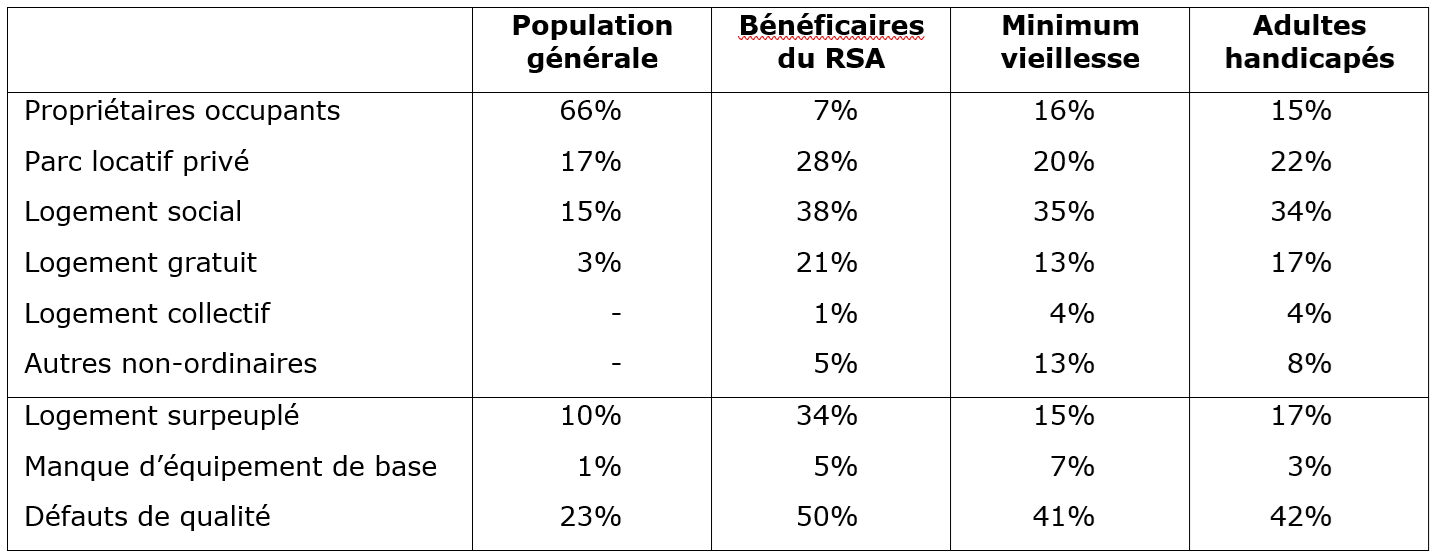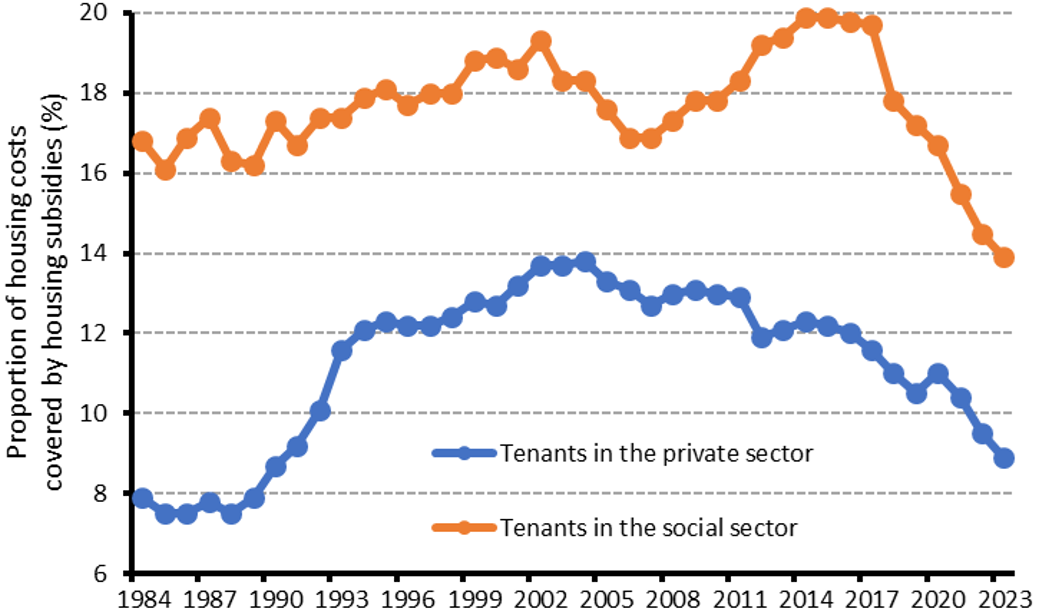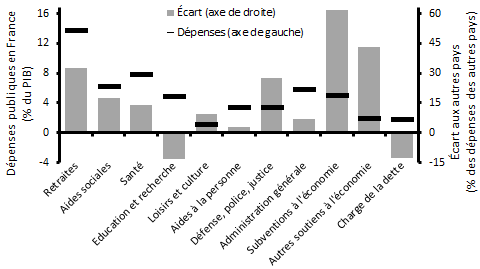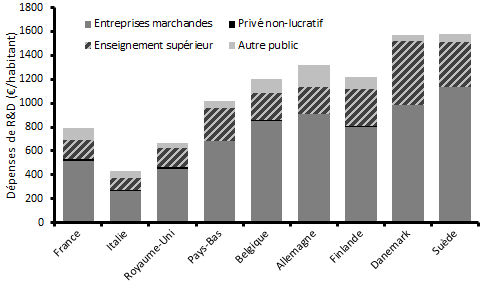Vers un autre monde (et donc une autre science économique) ?
Journal du MAUSS, 28 juin 2011
De très nombreux reproches sont régulièrement faits à l’encontre de l’analyse économique dite orthodoxe ou néoclassique. Cela s’observe dans nombre de lieux et de supports assez variés. L’expérience peut s’en faire notamment sur des blogs, des journaux, des revues ou des collectifs étudiants. En 2009, il est ressorti en périphérie d’un atelier de travail à Montréal intitulé « Workshop on Tax competition : how to meet the normative and political challenge » et rassemblant des juristes, des politologues, des philosophes et des économistes, que ce qui est principalement reproché à l’économie est un normatisme idéologique. Cette même critique ressort d’ailleurs fortement du numéro 30 de la revue du MAUSS : « Vers une autre science économique (et donc un autre monde) ? ». Ce numéro présente l’avantage de clarifier, d’expliciter et d’argumenter les critiques faites à cette analyse économique dominante. Cependant, si on ne peut qu’être globalement en accord avec beaucoup de ce qui est dit sur le fond, il apparaît que les reproches ne sont adressés ni aux bonnes personnes ou ni aux bons problèmes.
En fait, s’attaquer à l’économie néoclassique en tant que cadre analytique est se tromper d’adversaire et ne fait pas en soit avancer le débat dans le bon sens. Ce n’est pas cette discipline en elle-même qui est idéologiquement normative, mais des économistes en tant que personnes – et bien plus encore des non économistes – qui au mieux interprètent, au pire déforment des résultats scientifiques autour de leurs propres valeurs, camouflant le subterfuge sous un discours prétendument objectif et scientifique. Alors, à l’opposé de sa mise à l’index en tant que discipline scientifique, une utilisation de l’analyse économique néoclassique positive pourrait se révéler extrêmement utile dans un débat plus général de sciences sociales ou de politique économique. Et ce point de vue semble rejoindre le point 1 du manifeste institutionnaliste : « … la science économique, correctement interprétée, ne fait sens que vue comme le moment analytique de l’économie politique. » [1]. L’important est de pouvoir séparer ce moment analytique positif de l’introduction de valeurs en vue des propositions normatives de l’économie politique. Alors l’analyse économique néoclassique, correctement pratiquée, peut parmi d’autres disciplines participer pleinement de ce moment analytique.
La première partie de ce commentaire s’attache principalement à montrer que la vision de l’analyse économique néoclassique présentée dans le numéro 30 de la revue du MAUSS est caricaturale et erronée. Tout d’abord, il s’agit d’une simplification à outrance de ce cadre analytique où il finit par être réduit à ses premiers résultats, datant du XIXe siècle, et interprétés sans prendre en compte ce qui est de l’ordre de la conclusion ou de l’hypothèse. Ensuite, un portrait plus conforme de la science économique est présenté, où il est expliqué qu’elle est faite d’hypothèses et de méthodes très hétérogènes, non seulement entre courants mais également à l’intérieur même de la-dite orthodoxie. Cette hétérogénéité ne constitue pas une incohérence ni ne reflète uniquement des désaccords idéologiques. Elle existe par essence car il n’y a pas ni ne saurait y avoir de théorie générale et complète en économie. Enfin, la nette différence entre l’image de la science économique et ce qu’elle est vraiment serait en partie expliquée par la confusion existant entre un discours économique scientifique et un discours économique médiatique.
La deuxième partie de ce commentaire tente de comprendre où se situe effectivement l’idéologie dans les discours mis en cause. Même si la confusion est soigneusement cultivée par ceux qui présentent leur profession de foi idéologique comme des résultats scientifiques de l’analyse économique néoclassique, elle se situe non pas dans les raisonnements eux-même mais bien souvent dans les interprétations de ces raisonnements. Il est ensuite discuté la place des valeurs dans l’analyse économique et la nécessité de séparer clairement, aussi bien dans les réflexions que dans les discours, les parties positives et analytiques des parties normatives où doivent influer les valeurs. En effet, changer de valeurs ou d’idéologies sans séparer celles-ci des résultats positifs ne serait que changer un normatisme idéologique contre un autre et ne permettrait aucunement d’espérer un autre monde.
Une vision erronée de l’économie néoclassique
1/ Simplification à outrance et théorie du XIXe siècle
La vision de l’économie néoclassique, aussi bien celle donnée à travers le n°30 de la revue du MAUSS que celle donnée par de nombreux adversaires de l’économie néoclassique est bien souvent excessivement caricaturale, pour ne pas dire fausse, et pourrait se résumer en cette équation simpliste : « analyse économique néoclassique = idéologie néolibérale ». Plus généralement, l’économie néoclassique est bien souvent caricaturée sous les traits de ce que furent les débuts de ce courant. Ces débuts sont importants à connaître et à comprendre d’un point de vue épistémologique, mais correspondent à l’analyse économique du XIXe, qui a depuis été grandement perfectionnée et approfondie, afin de saisir au fur et à mesure de plus en plus de complexité.
Les théorèmes du bien-être
On trouve ainsi une caricature de ce type dans le point 4 du quasi manifeste institutionnaliste proposé par Alain Caillé : « la théorie classique de l’équilibre général […] affirme que la libre coordination entre de tels agents [homo œconomicus] conduit spontanément et automatiquement à un optimum économique » [2]. Plusieurs confusions existent sur ce résultat bien connu des économistes néoclassiques sous le nom de « premier théorème du bien-être ». Une première confusion réside dans la compréhension du terme « optimum ». Dans ce premier théorème du bien-être, cet « optimum » est un « optimum de Pareto », c’est à dire qu’on ne peut pas modifier la situation à partir d’un tel optimum en contentant tout le monde : tout déplacement depuis un optimum de Pareto engendre des perdants. Cet optimum, du fait qu’il s’appelle optimum, est souvent interprété comme un idéal à atteindre, mais il s’agit uniquement d’une interprétation. Il existe une infinité d’optima de Pareto et le fait d’en être un signifie seulement qu’il n’existe pas de gaspillage. D’ailleurs, la situation dictatoriale où une personne possède tout et les autres rien est un optimum de Pareto, sauf si ce dictateur peut accroître sa richesse personnelle en la partageant (c’est pourquoi des propriétaires donnent une part de leur capital pour rémunérer du travail : cela accroît leur richesse). Ce théorème affirme simplement que l’équilibre de concurrence pure et parfaite est un optimum de Pareto, mais absolument pas, ni que c’est celui que l’on souhaiterait socialement obtenir, ni d’ailleurs que la concurrence pure et parfaite existe réellement.
Une deuxième confusion réside en effet dans le fait que la phrase citée constitue le « alors » d’un « si… alors », et qu’il manque le si. Le « si » constitue l’ensemble des hypothèses dont la principale est « si l’économie est constituée de marchés de concurrence pure et parfaite », ce qui nécessite de nombreuses conditions (homo œconomicus, atomicité, homogénéité des produits, information parfaite…) qui elles-mêmes sont toutes bien évidemment des fictions tant elles sont extrêmes. Il est fréquent de croiser des individus ayant une interprétation au premier degré de ce théorème du bien-être (et parmi eux on retrouve notamment des hommes politiques, des fonctionnaires, des journalistes et même des économistes), il arrive même que certains comprennent les hypothèses comme des impératifs. Combien de fois entend-on : « la théorie néoclassique prétend que l’être humain est un homo œconomicus, que les marchés sont constitués de multiples petites entreprises, que l’information est parfaite », c’est absurde ! L’analyse néoclassique a simplement dit au début du XXe siècle : « si les marchés sont parfaits, alors l’allocation des ressources est en conformité avec le critère de Pareto ». Ensuite, une grande partie de la recherche depuis a consisté à relâcher une à une et le plus loin possible les hypothèses de la concurrence pure et parfaite pour comprendre ce qui se passe réellement.
Pour résumer la démarche, l’analyse néoclassique est partie d’un modèle idéal extrêmement simple, donc compréhensible dans son ensemble, puis a tenté de le compliquer de plus en plus. Ont été alors étudiés les cas de différentes concurrences de plus en plus imparfaites : présence de peu d’offreurs ou de peu de consommateurs, hétérogénéité des produits, information imparfaite ou asymétrique, et depuis récemment un grand pan est ouvert dans l’étude de la modélisation de comportements irrationnels, ce qui consiste à relâcher l’hypothèse de l’homo œconomicus lui-même. On peut critiquer en soi cette démarche consistant à partir d’une modélisation très simplifiée qu’on complique au fur et à mesure, elle a certainement des défauts. Toutefois, c’est une erreur de critiquer l’ensemble du programme de recherche en le confondant avec le modèle simplifié initial.
Une économie d’échange pur
Un autre exemple de caricature de l’analyse économique se trouve dans l’article de Nicolas Postel : « Hétérodoxie et Institution », dans lequel il présente trois points essentiels qui selon lui marquent la différence entre orthodoxie et hétérodoxie. Loin de montrer l’unité des hétérodoxes (pas plus que celle des orthodoxes d’ailleurs), cela schématise surtout une vision de l’analyse néoclassique actuelle qui me semble erronée.
Le premier point est : « Economie de production contre économie d’échange », où il présente l’analyse néoclassique comme une théorie d’échange pur, sans autre mécanismes expliquant les prix que ceux de l’offre et de la demande. Selon lui, ce que fait l’économie hétérodoxe et que ne fait pas l’économie orthodoxe, c’est relier les prix aux conditions de production et à l’entreprise. Pourtant, la production est déjà présente, certes de manière assez sommaire, dans les œuvres de Walras ou de Jevons [3]. Si une part d’idéologie cherchant à camoufler la lutte des classes n’est sûrement pas étrangère au succès originel de cette théorie, ces œuvres fondatrices ont rapidement été approfondies par des études marginalistes de la production. L’analyse néoclassique consiste en effet à confronter des fonctions d’offre et de demande, mais celles-ci sont le reflet de multiples éléments, dont notamment les institutions ainsi que les conditions et capacités de production. L’analyse des entreprises et de la production est donc bien présente dans la théorie néoclassique, et ce dès ses balbutiements. Encore une fois, la modélisation la plus simple de l’équilibre économique en concurrence pure et parfaite peut ne pas concevoir la production, et celle juste un peu plus complexe une production dessinée à grands traits. Cependant, le principe même de l’analyse néoclassique n’exclue en rien une compréhension plus fine des entreprises et de la production, tâche à laquelle se sont attelés de nombreux économistes travaillant dans un cadre analytique néoclassique.
Dans le même registre des procès d’intention intentés à l’analyse néoclassique, Nicolas Postel écrit un peu plus loin que « Walras cherchait à montrer que, en économie, le marché nous libérait de l’institution sociale » [4], il ajoute que « Le principe même de l’institution constitue un obstacle épistémologique pour le paradigme néoclassique » [5] et encore qu’« On connaît les difficultés du paradigme néoclassique à appréhender la protection sociale, l’investissement au travail, les déterminants salariaux, le phénomène syndical »[6]. Ces trois assertions sont fondamentalement fausses. Ce n’est pas parce que l’étude de ces principes institutionnels ne les modélise pas comme un déterminant direct du salaire – mais les mêlent à d’autres déterminants dans des fonctions d’offre et de demande qui ensuite permettent de déterminer le salaire – qu’ils ne sont pas pris en compte dans l’analyse économique néoclassique. Plusieurs exemples dans les parties suivantes en attestent.
Une économie capitaliste de marché
Le deuxième point est intitulé « Economie capitaliste contre économie de marché ». Encore une fois, il est probable qu’une des motivations de l’étude des marchés – quitte à occulter le caractère capitaliste – est un caractère idéologique de négation de la lutte des classes (surtout dans les présentations où tous les agents ont des biens matériels à échanger). Cependant, il est faux de faire ce procès à la recherche néoclassique actuelle qui est une étude d’une économie capitaliste à travers un fonctionnement de marché. On en revient d’ailleurs un peu au point précédent puisqu’à partir du moment où on analyse la production, qui est une production capitaliste pour les sociétés étudiées, on analyse de fait une économie capitaliste.
Par ailleurs, dans ce paragraphe, Nicolas Postel se réfère à Marx pour chasser l’idée de marché du travail. Pour lui, l’analyse néoclassique ne prend pas en compte le rapport salarial : « Les rapports d’échange sont considérés comme fondés sur l’égalité absolue, et non formelle, des échangistes et ne sont reliés à aucune détermination sociale » [7]. C’est à mon sens une autre vision erronée de l’analyse marginaliste. Le fait de modéliser la relation salariale par un marché du travail ne signifie ni que les rapports d’échanges sont fondés sur l’égalité absolue ni qu’ils ne sont reliés à aucune détermination sociale. Les fameuses fonctions d’offre et de demande pour le marché du travail sont le produit d’un grand nombre de facteurs dont les institutions font partie et peuvent entraîner une inégalité de pouvoir de négociation criante. Il est important de noter qu’il est pour le moins réducteur de limiter l’analyse néoclassique à la simple utilisation de telles fonctions d’offre et de demande. La compréhension des différents phénomènes qui les sous-tendent (et notamment les enjeux de protection sociale, d’investissement au travail, de phénomènes syndicaux et d’autres déterminants salariaux) font partie intégrante du programme de recherche néoclassique.
Nicolas Postel dit encore : « L’exploitation n’est pas le fait d’un rapport interindividuel qui opposerait des personnes moralement critiquables. Elle est au contraire un processus systémique et général qui s’impose à chaque travailleur, mais aussi à chaque capitaliste désireux de le rester et contraint, pour ce faire, de rechercher comme ses concurrents des gains de productivité en accumulant du capital et en maintenant minimale la rémunération du travail. » [8]. L’analyse néoclassique ne nie pas dans ses hypothèses l’existence d’un tel processus systémique, mais elle porte particulièrement son attention sur les conséquences en terme de décisions individuelles et de production globale du fait que chacun est contraint de rechercher comme ses concurrents des gains de productivité en accumulant du capital et en maintenant minimale la rémunération du travail.
De plus, il laisse entendre que cette rémunération minimale est la rémunération de subsistance uniquement, faisait référence à la « loi d’airain » des salaires. Or Marx est très critique envers cette loi dont on lui attribue la défense. Si une lecture avisée du Capital permet de le comprendre, il le rappelle encore plus clairement dans sa critique des programmes socialistes : « Ainsi, à l’avenir, le parti ouvrier allemand devra croire à la « loi d’airain » de Lassalle ! (…) Mais si j’admets la loi avec l’estampille de Lassalle, […] il me faut également en admettre le fondement. Et quel fondement ! (…) C’est la théorie malthusienne de la population. (…) Mais, si cette théorie est exacte, je ne puis plus abolir la loi, quand j’abolirai cent fois le travail salarié, parce qu’alors la loi ne régit pas simplement la loi du travail salarié, mais tout système social. » [9] Non, Marx considère la fixation du salaire au niveau de subsistance comme une simplification de la réalité. Pour lui, le salaire gravite autour de ce salaire de subsistance en fonction de l’offre et de la demande de travail, tout en restant proche de ce dernier du fait de la très grande asymétrie dans les rapports de force sur le marché du travail.
Dire que Marx pense que la loi d’airain des salaires est valide est aussi faux que dire que l’analyse néoclassique (on ne peut malheureusement pas en dire autant de tous les économistes néoclassiques) considère que les marchés réels sont en concurrence pure et parfaite. En effet, Marx opère avec une hypothèse forte pour simplifier sa modélisation quand l’intérêt de son analyse ne porte pas précisément sur les salaires, mais la lève aussitôt qu’il analyse le marché du travail en particulier. On peut ainsi lire dans Le Capital : « L’accroissement du capital renferme l’accroissement de sa partie variable. En d’autres termes, une quote-part de la plus-value capitalisée doit s’avancer en salaires. (…) Le progrès constant de l’accumulation doit même, tôt ou tard, amener une hausse graduelle des salaires. (…) chaque année fournira de l’emploi pour un nombre de salariés supérieur à celui de l’année précédente, et […] à un moment donné les besoins de l’accumulation commenceront à dépasser l’offre ordinaire de travail. Dès lors, le taux des salaires doit suivre un mouvement ascendant. » [10]. Et plus loin : « Tantôt c’est un excès en capital, provenant de l’accumulation accélérée, qui rend le travail offert relativement insuffisant et tend par conséquent à en élever le prix. Tantôt c’est un ralentissement de l’accumulation qui rend le travail offert relativement surabondant et en déprime le prix. » [11]
Si l’on voulait résumer la pensée de Marx avec les termes de Nicolas Postel, on dirait que l’exploitation est bien le fait d’un rapport interindividuel qui oppose des personnes moralement critiquables, mais ce rapport à lieu dans le cadre d’un processus systémique et général qui s’impose à chaque travailleur et à chaque capitaliste désireux de le rester. Pour exprimer les conditions de cette inégalité fondamentale sur le marché du travail en termes néoclassiques, on pourrait dire qu’elle vient du fait que le capitaliste n’a pas un besoin impérieux de travail, ou pour le moins peut survivre en minimisant sa demande : la demande de travail est relativement élastique, alors que l’ouvrier a besoin de travailler pour vivre : l’offre de travail est grandement inélastique. Il en résulte un prix minimal sur le marché du travail, mais variable en fonction des variations marginales de l’offre et de la demande : les salaires sont bas. Cette modélisation n’est pas qu’un jeu d’interprétations, elle est utile pour comprendre comment les changements dans ces élasticités, qui traduisent des variations du rapport de force, induisent des changements de salaires et de conditions de travail. Ainsi, la constitution de syndicats, comme la mise en place de systèmes sociaux de solidarité, permet d’augmenter le pouvoir de négociation des salariés par l’augmentation de l’élasticité de l’offre de travail, et ainsi de faire remonter les salaires.
Il est intéressant d’ailleurs d’utiliser ce schéma d’analyse pour comprendre les fortes baisses de salaires que l’occident connaît depuis les années 90. Après guerre, la force de travail n’étant pas en quantité colossale (faible offre de travail), et les besoins de reconstruction étant très importants (forte demande de travail), les salariés ont réussi à négocier d’importantes hausses de rémunérations, notamment sous la forme de conditions de travail et de protection sociale (car la protection sociale telle qu’élaborée en France est belle et bien une forme de rémunération non monétaire). Avec la chute de la « menace » communiste, et la hausse de l’offre de travail en général (en quantité et en qualité), le tout associé à une baisse de la demande de travail pour des raisons de diminution de la croissance productive et d’amélioration des technologies, l’élasticité de l’offre a baissé quand celle de la demande a augmenté, conduisant ainsi à une baisse des salaires réels à travers une augmentation inférieure à l’inflation et un recul de la protection sociale (par exemple, le passage progressif de la Sécurité Sociale vers des assurances privées).
L’économie monétaire et la loi de Say
Le troisième point est : « Economie monétaire contre économie réelle », où Nicolas Postel fustige la « loi de Say » (qui pour le coup date de 1803) et proclame que « l’unique explication analytiquement solide du chômage involontaire est bien celle de Keynes. » [12]. Tout d’abord, penser que l’analyse économique est restée à la loi de Say est très réducteur. Mais pour ce qui est du vrai débat derrière ces accusations rapides, il faut avouer que l’avancée énorme permise par l’œuvre de Keynes a eu des conséquences sur pratiquement tous les courants économiques, y compris le courant néoclassique parmi lequel de nombreux économistes étudient les phénomènes monétaires. On peut soit penser que les néoclassiques sont hypocrites et incohérents - avec la loi de Say affirmant que l’économie n’est que réelle et étudiant par ailleurs les phénomènes monétaires, soit penser que les sciences évoluent.
Par ailleurs, les néoclassiques, en plus de s’attacher à comprendre les phénomènes monétaires, s’attachent à comprendre également les effets réels, car il en existe. Il est donc pour le moins simplificateur de prétendre que le chômage keynésien est la seule explication du chômage involontaire. Outre la fixation de salaires minimums (soit directement par la loi, soit par d’autres contraintes sociales), ce qui a forcément pour effet de modifier l’offre et la demande de travail, Shapiro et Stiglitz ont ouvert une branche d’étude néoclassique en expliquant le chômage involontaire « à la Marx » ai sein d’un processus décentralisé [13]. Ils ont d’ailleurs modélisé la question de l’investissement au travail que Nicolas Postel pensait difficile à appréhender pour le paradigme néoclassique. Les idées présentées dans cet article sont très certainement issues de Keynes, et Stiglitz s’en réclame, mais la modélisation est sans conteste néoclassique.
Pour revenir au cas des salaires minimums, Keynes le considérait comme un déterminant du chômage volontaire, au moins dans la conception de volonté générale de la société. Cependant, si dire qu’il ne faut pas de salaires minimums pour éviter le chômage n’est qu’un argument idéologique en vue de faire baisser encore plus les salaires, nier tout lien entre les niveaux réglementaires des salaires et le chômage involontaire relève tout simplement de la destruction de thermomètre. La véritable question est de savoir si cette cause est faible ou importante devant les autres causes créatrices de chômage involontaire, et plus généralement si s’attacher à faire baisser les salaires est la solution la plus efficace et la moins coûteuse socialement pour faire baisser le chômage. L’analyse économique néoclassique peut alors grandement aider à répondre à cette question.
Discours scientifique et discours médiatique
Si les critiques adressées à l’analyse économique néoclassique sont souvent erronées, c’est probablement aussi parce que, comme le présente Jacques Sapir, il existe une grande confusion entre les discours économiques et les discours médiatiques. « Ainsi, alors que le discours du journalisme économique proclame depuis deux décennies que le protectionnisme est un mal absolu, nombre de travaux scientifiques aboutissent à un résultat inverse. Cet écart entre le discours économique médiatique et le discours scientifique constitue alors en lui-même un élément du débat à prendre en compte. » [14]. De ce point de vue, comme le discours médiatique se déclare bien souvent de la théorie néoclassique, il y a confusion entre le discours médiatique et l’économie néoclassique. On reproche alors à l’analyse néoclassique les simplifications et les falsifications du discours médiatique, avec, comme nous l’avons présenté plus haut, des procès d’intentions et des références à l’économie du XIXe siècle.
Ainsi, il existe une différence notable entre l’analyse néoclassique et le consensus de Washington. Ce dernier a effectivement été soutenu par des économistes néoclassiques, mais par des arguments tout à fait contestables à l’intérieur même de l’analyse économique néoclassique. En effet, les principes défendus ont de multiples influences, partiellement contradictoires, sur la situation des différents pays concernés. A ce titre, les effets pervers des principes prônés par le FMI et la banque mondiale, principalement pour les pays en voie de développement, étaient prévisibles et expliqués par la théorie néoclassique. Mais c’est sur le terrain médiatique, assumé aussi par les administrateurs de ces institutions et des principaux états membres, que le consensus de Washington l’a emporté, aidé en cela par un monde journalistique conciliant et quelques experts économiques renommés. Cependant, si le crédit qui leur est a priori accordé a fortement servi la cause du consensus de Washington du point de vue médiatique, ces économistes ne portent pas un consensus au sein de l’analyse scientifique néoclassique.
2/ Il n’existe pas de théorie générale de l’Homme
La présentation précédente des déterminants du chômage peut paraître décousue. Un article parlant d’un déterminant, un autre d’un autre. La raison en est principalement que la recherche économique néoclassique sérieuse a depuis longtemps perdu la prétention de constituer une théorie générale de l’économie. Dans son « Quasi-manifeste institutionnaliste », Alain Caillé parle beaucoup de théorie générale en sciences sociales. Cependant, outre le fait qu’il n’en existe pas actuellement de valide [15], il y a fort à parier qu’il ne puisse pas en exister une. L’homme et sa manière exacte de se comporter en société est certainement bien plus complexe (et probablement aléatoire) que ne pourrait en rendre compte n’importe qu’elle théorie générale finie. Ainsi, l’analyse économique néoclassique cherche à mettre en perspective des effets différents et éventuellement contradictoires, mais pas forcément de manière exhaustive. D’où l’accord partiel avec le point 10 du quasi-manifeste institutionnaliste : « L’économie politique institutionnaliste doit élaborer une analyse pertinente pour tous les niveaux de l’action (micro, macro, meso, etc.) » [16]. L’économie politique doit effectivement se baser sur une analyse multi-niveaux, mais il faut ajouter qu’il est illusoire d’espérer qu’une analyse couvre tous ces niveaux à la fois, et même toute l’hétérogénéité de chaque niveau. Il s’agit donc de s’appuyer sur des analyses multi-niveaux, et parmi celles-ci se trouve l’analyse économique néoclassique. Pour résumer ma pensée, et mon désaccord avec les points 10 et 11 de ce même quasi-manifeste institutionnaliste, l’économie politique ne peut pas reposer sur une théorie unique de l’action sociale et économique. Ces analyses multi-niveaux, non seulement en économie mais aussi plus généralement en sciences sociales, ne peuvent pas consister en une théorie générale de l’Homme : il ne saurait exister une théorie générale du comportement humain.
Quelle serait alors la cohérence de ces analyses multi-niveaux ? Elles consisteraient en une juxtaposition et une confrontation de touches et de modélisations, différentes selon le sujet d’étude forcément partiel. Il faut comprendre l’Homme en expliquant par parties ses décisions. Une des branches de ce grand projet consiste à définir différents « effets » sur ces décisions par modélisation en fonction du contexte. Et il se trouve que pour un nombre non négligeable de décisions, le caractère calculateur de l’Homme – qui ne définit certes pas l’Homme dans son ensemble mais est une de ses indéniables capacités – entre en compte. Se passer de l’étude des influences de ce caractère calculateur serait une grande erreur et rendrait plus parcellaire encore l’analyse des décisions humaines. Pascal Combemale écrit d’ailleurs que « l’homme n’est pas forcément œconomicus à la base, mais placé dans une société concurrentielle, il l’est ou il meurt » [17]. Peut-on douter que l’homme soit aujourd’hui placé dans un tel type de société ? La seconde partie reviendra sur la raison pour laquelle il est plongé dans cette société, mais à partir du moment où il l’est, il est impératif pour comprendre ses décisions d’étudier aussi ce qui découle de son caractère calculateur.
La conclusion de cela est que l’analyse économique néoclassique n’est qu’un des nombreux vecteurs de compréhension de l’homme en société, mais que c’est un vecteur performant. C’est un cadre analytique qui permet de comprendre beaucoup, comme l’admet d’une certaine manière Alain Caillé : « … des économistes orthodoxes intelligents et ouverts, comme il en est heureusement beaucoup, sont tout à fait susceptibles de se reconnaître eux aussi dans nombre de formulations non standards qui vont suivre. L’explication de ce paradoxe réside dans le fait que la force du modèle standard, c’est son formalisme largement tautologique qui, une fois débarrassé des connotations idéologiques dont il est le plus souvent lesté, lui permet de s’adapter à peu près à n’importe quel contenu. » [18]. Ce passage est extrêmement péjoratif et déclare comme non standard des formulations qui ne le sont pas (pas plus qu’elles ne sont standards il faut bien l’avouer), mais contient une vérité très importante : le cadre analytique néoclassique est un outil adaptable et efficace.
Lorsque Pascal Combemale parle de schizophrénie, il se rapproche de ce qu’Alain Caillé appelle un paradoxe : « … les économistes sont volontiers schizophrènes. Ceux dont le métier est d’analyser la conjoncture utilisent des modèles éclectiques dont l’armature reste souvent celle de la bonne vieille synthèse classico-keynésienne. (…) Par ailleurs, lorsque les questions se font plus précises, le praticien se soucie moins de théorie pure que du choix de la meilleure technique économétrique. (…) Le pragmatisme conduit à répondre de façon empirique à des énigmes concrètes » [19] ou encore : « … la force de l’orthodoxie réside profondément dans sa normativité, laquelle se nourrit d’une anthropologie et d’une philosophie politique » [20]. On peut reformuler de manière moins péjorative cette phrase en disant que des orthodoxes actuels font feu de tout bois pour comprendre le monde, qu’ils confrontent différents modèles et différents effets, cherchant le plus adapté à chaque situation. Il se trouve que c’est sûrement une bonne solution s’il n’existe pas de théorie générale de l’homme.
Mais bien entendu ce grand projet de sciences sociales paraîtrait bien vain s’il ne consistait qu’en un catalogue de tous les effets possibles, issus de différents raisonnements et hypothèses, et donc difficile à confronter. C’est là que peut-être la dénomination de sciences se justifie par la partie empirique de ce travail, qui consiste par tous moyens possibles, - études de terrain qualitatives, analyses statistiques de situations passées ou expérimentations -, à tester et à comparer l’importance et la prévalence des différents effets.
Normativité et violence symbolique
Outre les fausses critiques sur la réalité de l’analyse économique néoclassique, il lui est souvent reproché d’être idéologique ; plus précisément de défendre une idéologie de libéralisme économique, de non intervention publique, de concurrence sur les marchés… Plusieurs questions se posent alors. La première sous partie de cette seconde section interroge la réalité de l’existence de l’idéologie dans la science économique elle-même et dans nombre de ses utilisations ? Si, pour revenir à la séparation précédemment présentée, les discours économiques médiatiques sont incontestablement idéologiques, il faut bien constater que beaucoup de discours scientifiques le sont aussi, sans pour autant qu’ils le soient forcément. En effet, l’idéologie n’est pas un fondement essentiel de l’analyse néoclassique, mais un ajout. La seconde sous partie se penche sur les buts et surtout les influences réelles de cette idéologie ? La réponse à cette question différera bien évidemment suivant qu’on l’abordera avec une vision idéaliste ou matérialiste du changement social. Enfin, si le but est de changer le monde (à moins que le but soit uniquement de changer de science économique et que le changement de monde ne reste qu’un dommage collatéral), quelle aide l’économiste peut-il apporter ? La troisième sous partie tentera alors de définir dans quelle mesure il doit incorporer ses valeurs dans ses analyses, et surtout comment et à quel moment du raisonnement.
1/ Où se situe l’idéologie ?
A lire le numéro 30 de la revue du MAUSS, il nous est donnée l’impression que l’analyse économique néoclassique repose sur des bases essentiellement idéologiques et qu’elle ne peut exister sans l’idéologie de libre concurrence et de laisser faire. Or c’est profondément faux. Le type de raisonnement utilisé dans cette analyse n’est pas plus idéologique qu’un autre, et, pour ne parler que des études économiques sérieuses, l’idéologie n’a que deux endroits pour se terrer, lorsqu’elle se terre effectivement : dans les hypothèses et dans les conclusions. En effet, le raisonnement économique orthodoxe n’est rien d’autre qu’une induction, qu’un « si… alors ». Et l’idéologie intervient souvent dans le fait que le « si » est tu et que le « alors » est interprété, mais ces erreurs n’enlèvent en rien la valeur de l’induction.
Pour ce qui est du « si », l’idéologie intervient principalement dans son oubli. C’est à dire que l’on considère comme un fait absolu ou comme une situation naturelle et inévitable ce qui est de l’ordre de la construction sociale. Le « si » le plus souvent oublié est ainsi : « si les hommes étudiés participent à une société de production capitaliste ». L’analyse économique néoclassique tend souvent à interpréter ses résultats comme généraux, alors qu’ils ne sont valables que dans un type précis de société. Cependant, tant que l’on reste dans cette société capitaliste, les résultats néoclassiques sont valables.
Parallèlement, l’endroit où l’on retrouve le plus souvent l’idéologie est dans l’interprétation de la conclusion. Il est en effet compréhensible qu’un auteur tente de réinterpréter les résultats au regard de ses valeurs. Mais cela conduit bien souvent à des confusions et des sur-interprétations. Un des meilleurs exemples est ce fameux théorème du bien-être déjà discuté. Outre le périmètre de validité qui est bien souvent élargi à tort, ce théorème ne dit ni plus ni moins que si toutes les hypothèses sont respectées, l’équilibre de marché constitue une allocation des facteurs et des produits optimale au sens de Pareto, ce qui ne veut absolument pas dire que cette situation soit souhaitable. Le passage « d’optimum de Pareto » à « situation souhaitable pour la société » réside bien souvent dans une méconnaissance profonde du concept d’optimum de Pareto, et s’avère probablement très utile à certaines idéologies. Il n’en demeure pas moins que le théorème du bien-être ne dit absolument pas que la situation émanant de la libre concurrence est la situation économique socialement souhaitable.
Comme présenté précédemment, des auteurs du numéro 30 de la revue du MAUSS : « Vers une autre science économique (et donc un autre monde) ? » admettent au moins partiellement la pertinence des hypothèses néoclassiques ; ainsi, Pascal Combemale écrit « l’homme n’est pas forcément œconomicus à la base, mais placé dans une société concurrentielle, il l’est ou il meurt » [21]. Ainsi, l’étude d’une société fortement concurrentielle comme l’est la société de production capitaliste semble donc justifier à ses yeux l’hypothèse d’homo-oeconomicus. Cependant, il semble dire, et d’autres auteurs dans le même numéro avec lui, que c’est la science économique néoclassique qui est responsable de ce monde concurrentiel. Ainsi, ce serait l’analyse économique néoclassique qui pousserait l’homme à se comporter comme un homo œconomicus. C’est donner là un énorme pouvoir à cette science, pouvoir qu’elle n’a probablement pas. Certes, il est indéniable qu’il existe bien souvent un effet réciproque d’une science sur son objet d’étude, et cela d’autant plus que cette science est sociale et qu’elle a des prétentions normatives. Mais, si nous vivons dans un monde capitaliste, cela n’est à l’évidence pas le seul fait des économistes mais relève de bien d’autres causes.
Alors, nier les résultats scientifiques de l’analyse économique néoclassique – et pas ceux prétendus tels - lorsqu’on vit dans une économie capitaliste revient à casser le thermomètre lorsqu’on est malade. Il y a fort à parier que ce monde concurrentiel a été instauré non pas parce que des économistes se sont dit que ce monde là serait bien, mais bien parce que la classe qui a pris le pouvoir économique après la révolution industrielle a eu à la fois l’intérêt et le pouvoir politique de l’instaurer. L’idéologie agit ensuite et permet de conserver le système mis en place sans avoir besoin de renier la démocratie.
Il apparaît tout d’abord un phénomène que Karl Marx et Georg Lukacs appellent la fausse conscience. C’est à dire que la classe dominante, qui a intérêt dans le système mis en place, le justifie non par son pouvoir et son intérêt, mais par des raisons naturelles : là se trouve l’idéologie. Ensuite, ce que Pierre Bourdieu appelle la violence symbolique se produit, la classe dominante impose à l’ensemble de la société cette idéologie qui justifie ex post l’organisation sociale. Il est vrai que cette violence symbolique agit notamment – mais pas uniquement – sous des apparences de théorie économique néoclassique. Cependant, il s’agit là de théorie économique néoclassique déformée ou mal interprétée. C’est le discours médiatique dont parle Jacques Sapir : « … le discours économique médiatique se prétend un discours scientifique, et de ce fait hors de l’espace de la contestation politique. Il se veut une « vérité » au sens scientifique, au moment même où il s’éloigne délibérément et consciemment des résultats des travaux scientifiques. » [22]. Et rejeter ainsi l’analyse néoclassique véritable ne changerait pas cette violence symbolique – qui trouverait d’autres vecteurs – et encore moins le réel rapport de force qui resterait inchangé.
A l’opposé, la négation de certains résultats de l’analyse économique néoclassique peut entretenir une confusion qui profite grandement à l’idéologie dominante. En effet, si un résultat de l’analyse économique néoclassique bien interprété relie par une déduction une condition à une conclusion, quiconque désapprouve la conclusion devrait s’attacher à faire en sorte que la condition ne soit plus effective. Nier à tort le raisonnement, comme le font des critiques de l’analyse économique néoclassique, permettrait seulement de détacher dans l’esprit des opposants la conclusion de la condition, et servirait uniquement à défendre la condition. Ainsi, pour revenir à l’exemple qui nous préoccupe, nier le raisonnement de l’analyse néoclassique qui dit qu’un système de production capitaliste (condition) conduit forcément à un niveau élevé de violence et d’inégalités (conclusion) ne permettrait jamais de diminuer significativement les inégalités. Cela participe au contraire de l’idéologie qui tend à protéger le système actuel, soit en le déclarant comme naturel, soit en le détachant de ses conséquences réelles.
Dans ce cadre, il est effectivement important que l’ensemble des économistes, et parmi eux plus encore les quelques néoclassiques qui ne sont pas dupes de la supercherie, travaillent à lever le voile de cette idéologie. Mais ici il n’est pas question de méthode d’analyse, car l’idéologie n’a pas atteint l’analyse économique néoclassique mais bon nombre d’économistes, néoclassiques ou non.
2/ Idéalisme ou matérialisme
Une partie des désaccords avec les articles de la revue du MAUSS présentés précédemment se résument à un désaccord fondamental sur la conception du changement social : vue idéaliste contre vue matérialiste. Dire que l’analyse économique néoclassique est la force qui a permis d’instaurer le capitalisme est idéaliste. Dire que l’analyse économique néoclassique étudie le capitalisme qui a été instauré par les révolutions industrielle et bourgeoise est matérialiste. On retrouve bien cette problématique dans les titres, est-ce parce qu’on élaborera une nouvelle théorie économique que le monde changera par l’adoption de ces nouvelles idées : la version idéaliste « Vers une autre science économique (et donc un autre monde) ? » ou est-ce lorsqu’on changera de mode de production et donc de monde, qu’il faudra inventer une autre science économique pour en rendre compte : la version matérialiste « Vers un autre monde (et donc une autre science économique) ? ».
Sur ce point de vue, on peut revenir à cette loi d’airain dont parle Nicolas Postel et prendre comme exemple les mouvements généraux des salaires dans les pays occidentaux dans la seconde moitié du XXe siècle. Est-ce aux idées que sont dues ces variations depuis l’après-guerre, ou aux conditions de la production ? L’analyse néoclassique du marché du travail, avec la détermination d’une offre et d’une demande de travail liées aux besoins de reconstruction, aux institutions, etc. permet de comprendre en partie pourquoi la fameuse loi d’airain ne s’est pas trouvée vérifiée notamment depuis la fin de la seconde guerre mondiale.
Après celle-ci, les besoins de reconstruction, et ainsi l’accumulation rapide du capital et la forte croissance allaient de paire avec une très forte demande de travail. L’offre de travail, pas particulièrement augmentée par la guerre, s’est retrouvée relativement faible devant la demande. Dès lors, les salaires ne pouvaient qu’augmenter. Cette augmentation des salaires ne s’est pas faite uniquement en termes monétaires, mais surtout en termes de protection sociale : la protection sociale à la française est bel et bien une forme de rémunération différée et non une forme de solidarité [23]. Ainsi, la constitution du modèle social après guerre n’est pas dû à un nouveau courant d’idées, basé sur l’humanisme et la solidarité, mais bel et bien à un renforcement du pouvoir des travailleurs dans leur rapport de force vis-à-vis de leurs employeurs. Bien entendu, le pouvoir des syndicats de l’époque n’a pas été étranger aux acquis de protection sociale, mais ce pouvoir lui-même a dérivé au moins en partie d’un rapport de forces modifié et n’en a pas seulement été la cause.
À la fin du XXe siècle, ce rapport de forces s’est inversé. La forte hausse de la productivité (elle-même due à de nombreux facteurs que l’analyse économique participe à expliquer) a été une des forces visant à diminuer la demande de travail, alors que l’offre n’avait aucune raison de diminuer par ailleurs. Ce renversement du rapport de forces entre l’offre et la demande de travail devait naturellement entraîner une diminution des salaires. Cette baisse des salaires s’est d’abord produite via une augmentation nominale inférieure à l’inflation, puis le mouvement s’est accéléré avec la remise en cause de bon nombre de rémunérations non monétaires.
L’idéologie du travailler plus et plus longtemps, de la supériorité des assurances privées sur les assurances publiques existe aujourd’hui, mais elle n’est pas la cause réelle et première de la baisse des salaires et de la détérioration de l’accès aux soins, elle n’en est qu’une justification a posteriori. La véritable cause se trouve dans les modifications de l’offre et de la demande de travail, non du fait d’idéologies mais bien pour des raisons structurelles et économiques permises par le système de production capitaliste. La théorie néoclassique offre un bon outil pour comprendre les conséquences en termes de salaires des variations de ce rapport de force entre l’offre et la demande de travail. Alors, la création d’une idéologie alternative serait-elle suffisante pour inverser ce rapport de force ou un changement en profondeur de la société et des ressorts de la production est-elle nécessaire ?
3/ Quelle forme d’analyse et quels valeurs ?
Mais d’où viendra alors ce changement ? Sûrement pas de la simple attaque de l’économie néoclassique. Un changement de la société elle-même est nécessaire, et c’est pourquoi l’analyse néoclassique peut être utile afin de comprendre les facteurs qui doivent absolument être modifiés sous peine de ne rendre les changements que marginaux. Si on souhaite changer le « alors » du raisonnement économique, il faut prendre en compte le raisonnement pour pouvoir remonter au « si » originel et tenter d’agir politiquement sur lui. L’analyse néoclassique ne construit certes pas le monde futur, mais elle permet de comprendre le monde présent, et de faire le lien entre ses institutions et leurs conséquences économiques.
Dans ce sens, une partie des attaques contre l’orthodoxie présentées dans le numéro 30 de la revue du MAUSS se trompe d’adversaire. Cette confusion est particulièrement visible dans la conclusion de Pascal Combemale : « (…) l’hétérodoxie ne peut espérer la combattre [l’orthodoxie] sans dessiner un autre horizon. » [24]. On pourrait attendre plutôt l’inverse : pour pouvoir dessiner un autre monde, il faut combattre l’économie néoclassique, mais ce serait tout aussi faux. Le but est-il de combattre la science économique néoclassique, quitte pour cela à dessiner un autre monde ? Ou le but est-il bien de construire un autre monde, quitte alors à utiliser les enseignements de la science économique néoclassique ?
Alain Caillé semble s’intéresser, quant à lui, plus particulièrement à la définition d’un nouveau monde, et propose pour cela comme solution normative : « La conclusion la plus générale qu’il soit possible de tirer est qu’on ne peut pas avoir d’efficacité économique durable sans édifier une communauté politique et éthique durable parce que forte et vivante. » [25]. Il propose de bâtir une communauté démocratique, morale et juste, à partir de laquelle « l’économie politique institutionnaliste [parviendrait] à déterminer le meilleur agencement institutionnel pour une société donnée à un moment donné. » [26]. La question qui se pose alors est de savoir jusqu’où on appelle le cadre social « agencement institutionnel » ? Y a-t’il une limite aux principes qu’on peut remettre en cause ? Et une communauté démocratique, morale et juste, parviendrait-t-elle à renverser l’idéologie et la violence symbolique pour faire appliquer démocratiquement « le meilleur agencement institutionnel » même s’il va à l’encontre d’intérêts qui ont un poids certain dans les décisions dites démocratiques ?
Il y a fort à parier que pour parvenir à ce but, cette économie politique, qu’on l’appelle institutionnaliste ou autrement, qui se doit d’être normative, devra s’attacher à comparer, au regard des valeurs qu’elle a définies comme siennes, les conséquences économiques et sociales des différents agencements institutionnels. Pour mener à bien cette comparaison, l’analyse économique néoclassique positive, aussi bien que nombre d’autres disciplines positives, pourra être d’une grande utilité.
Quant à l’aspect clairement idéaliste, qui dériverait vers l’utopie, de la proposition d’Alain Caillé, il est encore plus voyant dans sa conclusion : « Une bonne réforme est celle que personne (et même pas ses opposants lorsqu’ils ont remporté les élections suivantes) ne songe plus à abolir une fois qu’elle a été effectuée. » [27]. C’est se tromper doublement. Premièrement, c’est oublier un peu trop que certains ont un intérêt réel dans la situation présente, dans l’inégalité et la soumission. Encore une fois, nier la lutte des classes ne résout pas le problème des intérêts divergents. Deuxièmement, cela semblerait dire, par exemple, que ce que l’opposition Jospin n’a pas enlevé des lois Pasqua-Debré et ce que la prochaine opposition hypothétique n’enlèvera pas des lois Sarkozy-Hortefeux (pour ne citer qu’elles) sont de bonnes réformes ? C’est là oublier un peu vite que la violence symbolique et l’idéologie sont aussi là pour pérenniser les réformes favorables à ceux qui sont peut-être moins nombreux mais plus puissants dans le rapport de force politique, économique et social.
Ainsi, il n’est pas utile de tenter de construire une nouvelle science économique en remplaçant une idéologie par une autre. A l’inverse, il faut justement enfin séparer autant que faire se peut les discours positifs des discours normatifs. Un des problèmes actuels est que ces discours sont mélangés et qu’est présenté sous un (faux) jour positif ce qui est normatif et favorable à une classe restreinte possédant les capitaux productifs. Jouer le jeu dans l’autre sens est voué à l’échec. Il faut au contraire séparer l’analyse positive des valeurs, défendre une analyse économique et sociale positive (dont l’analyse économique néoclassique). Le raisonnement (tout ce qui se trouve entre le « si » originel et le « alors » final) doit s’attacher à être le plus imperméable possible aux valeurs, quelles qu’elles soient. Le rôle des analystes est alors de dissocier les discours idéologiques des discours scientifiques, de lever le voile de l’idéologie, pour comprendre quel est le « si » qui conduit au « alors » qu’on vit aujourd’hui. Ensuite seulement doivent entrent en scène les valeurs, qui doivent alors être clairement affichées, assumées et défendues, dans l’interprétation des résultats et dans les conclusions politiques à en tirer.
Ce travail doit être fait par une science sociale non généralisante, qui cherche à déterminer un par un les effets potentiels, quitte à avoir recours à différentes hypothèses, différentes méthodologies, différents niveaux de généralisation. Et ainsi cette science peut et doit se décomposer en plusieurs types d’analyses, comprenant entre autres l’analyse économique néoclassique. De ce point de vue, il n’y a ainsi pas d’unité entre les hétérodoxies et les différences entres elles sont plus grandes qu’entre l’analyse néoclassique et certaines de ces hétérodoxies. Leur seul point commun est d’être mises à l’écart par les néoclassiques, aidés par le discours médiatique.
Il parait ensuite clair que ce catalogue de différents effets, multiples et contradictoires, ne peut pas permettre à lui seul de réaliser l’interprétation souhaitée en terme d’économie politique. Préalablement, ces différents effets doivent être testés et comparés. Pour ce faire, il existe de nombreuses méthodologies empiriques développées par différentes communautés scientifiques : des analyses quantitatives ou qualitatives, issues d’observations de situations passées ou de processus expérimentaux. Les économistes néoclassiques notamment ont développé des outils statistiques qui savent se révéler extrêmement utiles dans ce type de projet scientifique.
[1] Alain Caillé, Un quasi-manifeste institutionnaliste. Revue du MAUSS n° 30, Vers une autre Science Economique (et donc un autre monde) ? (2007), p. 38.
[2] Ibid. p. 39.
[3] Walras et Jevons sont considérés comme deux des trois fondateurs de l’économie marginaliste au cours des années 1870, le troisième étant Menger.
[4] Nicolas Postel, Hétérodoxie et institution. Revue du MAUSS n° 30, Vers une autre Science Economique (et donc un autre monde) ? (2007), pp. 79-80.
[5] Ibid. p. 80.
[6] Ibid. p. 83.
[7] Ibid. p.74.
[8] Ibid, p. 73.
[9] Karl Marx et Friedrich Engels. Programmes socialistes, critiques des projets de Gotha et d’Erfurt. Cahiers mensuels Spartacus, 2ème série (1971), n° 42, pp. 29-30.
[10] Karl Marx. Le capital. Editions sociales, Paris (1977), tome III, p. 55.
[11] Ibid. p. 60.
[12] Nicolas Postel, Hétérodoxie et institution. Revue du MAUSS n° 30, Vers une autre Science Economique (et donc un autre monde) ? (2007), p. 75.
[13] Carl Shapiro et Joseph Stiglitz. Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device. American Economic Review n° 74 (1984), pp. 433-444.
[14] Jacques Sapir, Libre échange, croissance et développement : quelques mythe de l’économie vulgaire. Revue du MAUSS n° 30, Vers une autre Science Economique (et donc un autre monde) ? (2007), p. 151.
[15] Pour qu’une théorie générale soit valide, elle doit l’être en tout point. Si un seul point n’est pas valide, la théorie n’est plus générale mais partielle, pour les parties où elle n’est pas invalidée.
[16] Alain Caillé, Un quasi manifeste institutionnaliste. Revue du MAUSS n° 30, Vers une autre Science Economique (et donc un aute monde) ? (2007), p. 42.
[17] Pascale Combemale, L’hétérodoxie encore : continuer le combat, mais lequel ?. Revue du MAUSS n° 30, Vers une autre Science Economique (et donc un autre monde) ? (2007), p. 63.
[18] Alain Caillé, Un quasi-manifeste institutionnaliste. Revue du MAUSS n° 30, Vers une autre Sciences Economique (et donc un autre monde) ?, p. 33.
[19] Pascale Combemale, L’hétérodoxie encore : continuer le combat, mais lequel ?. Revue du MAUSS n° 30, Vers une autre Science Economique (et donc un autre monde) ? (2007), p. 59.
[20] Ibid. p. 67.
[21] Ibid, p. 63.
[22] Jacques Sapir, Libre échange, croissance et développement : quelques mythe de l’économie vulgaire. Revue du MAUSS n° 30, Vers une autre Science Economique (et donc un autre monde) ? (2007), p. 151.
[23] Il ne faut pas en effet confondre rémunération et solidarité. En France par exemple, le système de protection sociale (assurances chômage et maladie, retraites) est un système assurantiel qui n’est autre qu’une forme de rémunération du travail. Ceci est particulièrement visible avec le chômage et la retraite, pour lesquels les prestations sont proportionnelles aux cotisations. En revanche, les aides de types AME-CMU, RSA ou minimum vieillesse sont de l’ordre de la solidarité.
[24] Pascale Combemale, L’hétérodoxie encore : continuer le combat, mais lequel ?. Revue du MAUSS n° 30, Vers une autre Science Economique (et donc un autre monde) ? (2007), p.67.
[25] Alain Caillé, Un quasi-manifeste institutionnaliste. Revue du MAUSS n° 30, Vers une autre Science Economique (et donc un autre monde) ? (2007), p. 43.
[26] Ibid. p. 45.
[27] Ibid. p.46.
[retour ; haut de page]